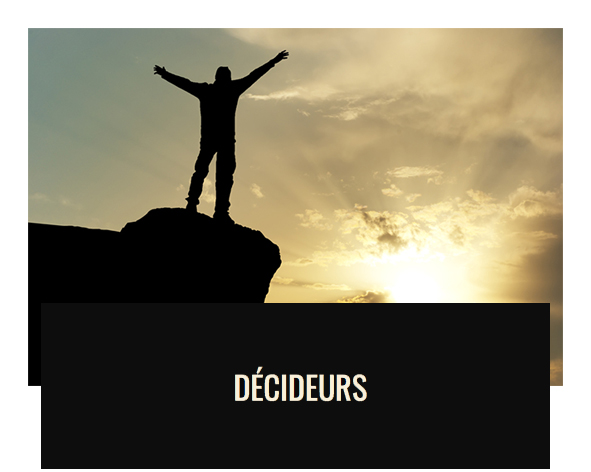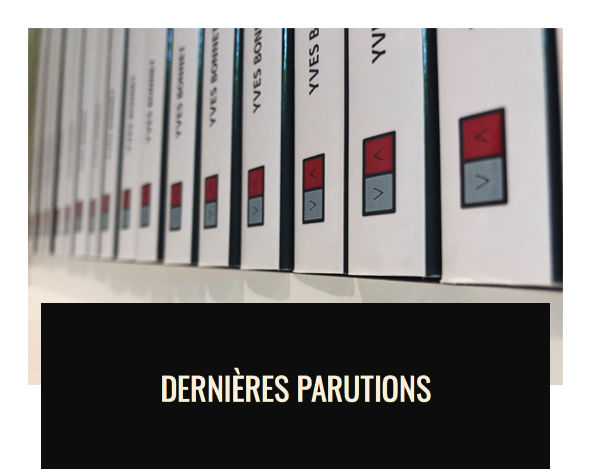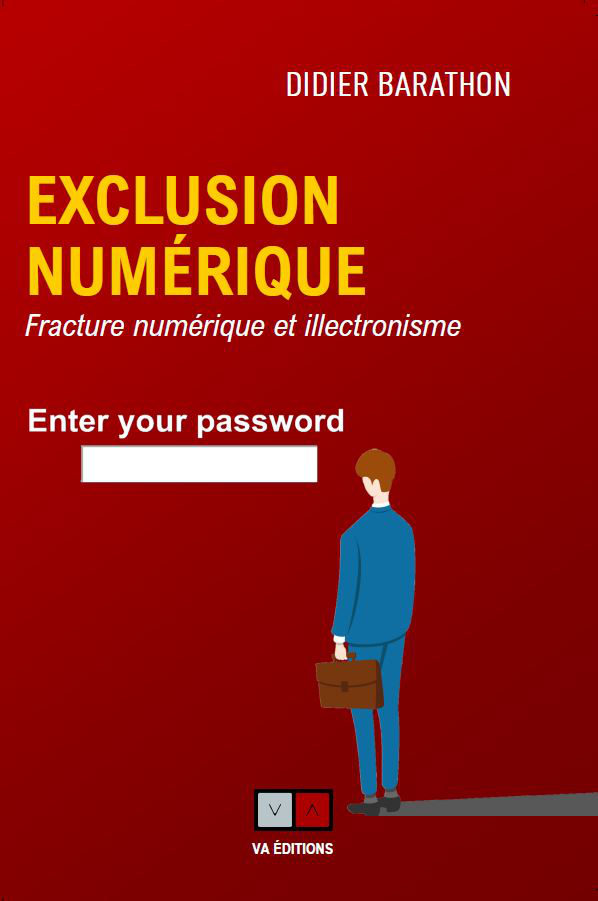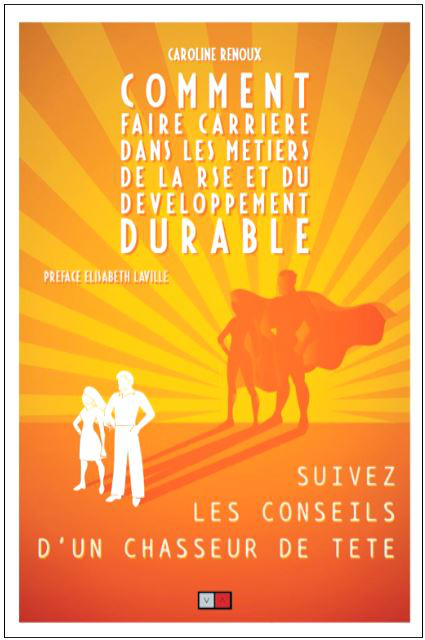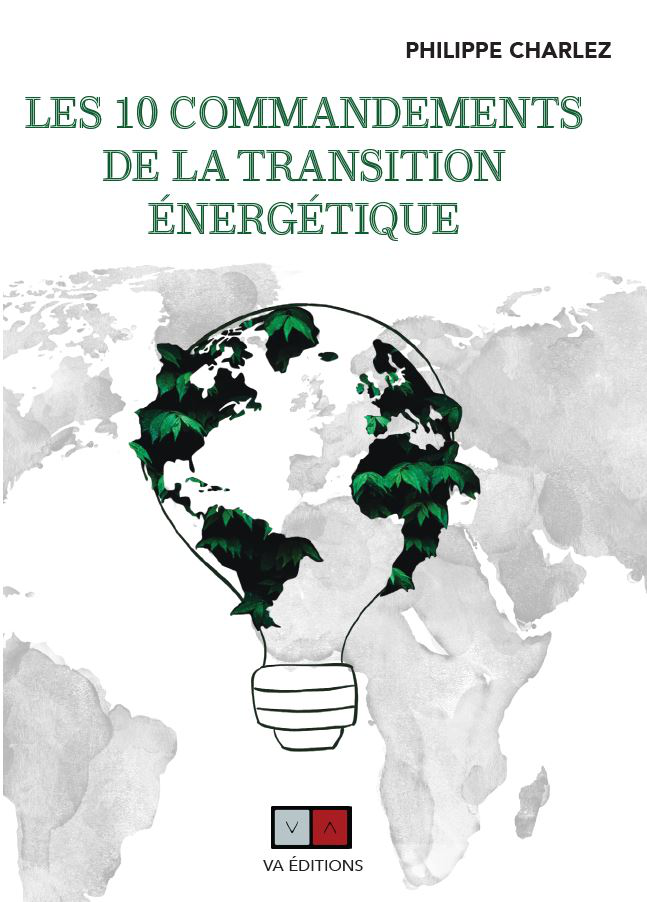Un accord d’entrave à la concurrence entre constructeurs automobiles
Le 1er avril 2025, la Commission européenne a annoncé avoir infligé 458 millions d’euros d’amende à quinze groupes automobiles pour avoir coordonné leurs pratiques en matière de traitement des véhicules en fin de vie. Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une enquête ouverte plusieurs années auparavant, révélant des accords anticoncurrentiels prolongés entre les principaux acteurs du secteur.
La Commission européenne a établi que, sur la période allant du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017, les constructeurs automobiles concernés ont pris part à une entente horizontale visant à limiter leur exposition aux coûts liés au recyclage des véhicules hors d’usage (VHU). Ces pratiques concernaient spécifiquement deux volets : le refus concerté de rémunérer les centres de traitement agréés et l’engagement commun à ne pas se livrer concurrence sur les taux de matériaux recyclés utilisés dans la production des véhicules neufs.
Selon l’institution européenne, l’objectif de cette coordination était de maintenir artificiellement bas les coûts de fin de cycle, en contournant les obligations imposées par la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage. Les entreprises ont partagé entre elles des informations sensibles relatives à leurs contrats individuels avec les démolisseurs, et ont restreint volontairement toute communication commerciale mettant en avant l’usage de matériaux recyclés dans leurs modèles.
La Commission européenne a établi que, sur la période allant du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017, les constructeurs automobiles concernés ont pris part à une entente horizontale visant à limiter leur exposition aux coûts liés au recyclage des véhicules hors d’usage (VHU). Ces pratiques concernaient spécifiquement deux volets : le refus concerté de rémunérer les centres de traitement agréés et l’engagement commun à ne pas se livrer concurrence sur les taux de matériaux recyclés utilisés dans la production des véhicules neufs.
Selon l’institution européenne, l’objectif de cette coordination était de maintenir artificiellement bas les coûts de fin de cycle, en contournant les obligations imposées par la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage. Les entreprises ont partagé entre elles des informations sensibles relatives à leurs contrats individuels avec les démolisseurs, et ont restreint volontairement toute communication commerciale mettant en avant l’usage de matériaux recyclés dans leurs modèles.
Un dispositif de collusion structuré autour de l’ACEA
L’affaire se distingue par l’implication de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), condamnée à 500 000 euros d’amende pour avoir joué un rôle actif de facilitateur dans les pratiques de collusion.
Selon la Commission, l’ACEA a organisé de nombreuses réunions de coordination, formalisant ainsi une structure d’échange régulier entre concurrents directs. Cette implication associative confère au cartel une dimension institutionnelle inhabituelle, transformant une entente informelle en mécanisme pérenne de distorsion du marché.
Selon la Commission, l’ACEA a organisé de nombreuses réunions de coordination, formalisant ainsi une structure d’échange régulier entre concurrents directs. Cette implication associative confère au cartel une dimension institutionnelle inhabituelle, transformant une entente informelle en mécanisme pérenne de distorsion du marché.
Répartition des sanctions : des montants records
La répartition des sanctions illustre le degré d’implication et la taille économique des opérateurs sanctionnés. Parmi les entreprises les plus touchées :
Les amendes prononcées tiennent compte de plusieurs facteurs : la durée de participation au cartel, le chiffre d’affaires annuel des groupes concernés, ainsi que la reconnaissance de culpabilité par les entreprises, qui a permis une réduction de 10 % du montant initial des sanctions pour plusieurs acteurs.
- Volkswagen Group : 127,69 millions d’euros,
- Renault/Nissan : 81,46 millions d’euros,
- Stellantis : 74,93 millions d’euros,
- Ford : 41,53 millions d’euros,
- BMW : 24,58 millions d’euros,
- Toyota : 23,55 millions d’euros.
Les amendes prononcées tiennent compte de plusieurs facteurs : la durée de participation au cartel, le chiffre d’affaires annuel des groupes concernés, ainsi que la reconnaissance de culpabilité par les entreprises, qui a permis une réduction de 10 % du montant initial des sanctions pour plusieurs acteurs.